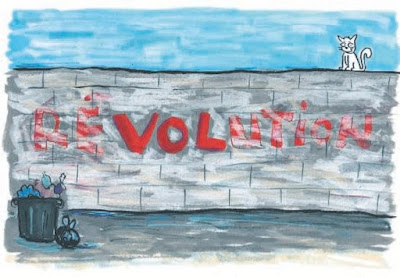Professeure de lettres franco-tunisienne, elle a vécu la «révolution
du jasmin» de l’extérieur. Elle signe un premier roman qui répond
à son besoin de comprendre ce bouleversement. Et qui, au-delà de
l’enquête, part à la rencontre de personnages presque défaits mais décidés à reconstruire.
Son amour des livres remonte à l’enfance, où elle écrit contes, poèmes, histoires. Sa double culture - française et tunisienne -, la ville de Tunis, bordée par la Méditerranée, où elle grandit, sèment en elle un désir d’ailleurs, de découverte du monde par-delà les mers. Née en 1982, Hella effectue ses études universitaires de lettres en France, à Paris. Globe-trotteuse en Équateur, au Sénégal. Elle est actuellement professeure de lettres à Antananarivo, à Madagascar, et formatrice d’enseignants dans la zone océan Indien. Elle signe son entrée en littérature avec Noces de jasmin (JC Lattès), un roman choral.
Plusieurs personnages appartenant à différentes générations témoignent de leur vécu pendant la révolution tunisienne, en janvier 2011, à quelques jours de la chute du dictateur Ben Ali. Une oeuvre fine et singulière reliant la petite et la grande Histoire, voix intimes et universel�et trotteuse incarné de la révolution dite du jasmin, le soulèvement d’un peuple pour ses droits, contre une dictature. À travers ce regard intérieur, introspectif, elle évoque aussi le métissage des cultures, l’amour, les secrets de famille, la transmission, la quête de liberté.
QS : Comment avez-vous vécu la révolution tunisienne?
Hella Feki: Je l’ai suivie depuis la France, où j’exerçais alors en tant que professeure de lettres. Pendant les vacances de Noël, j’étais rentrée à Tunis. On sentait qu’un événement important était en train de se tramer dans les provinces, sans pouvoir en saisir la nature exacte ni l’aboutissement. À mon retour à Paris, pendant des mois, j’ai acheté tous les journaux et conservé les articles sur la révolution. J’avais besoin de garder une mémoire de ces événements. Des années après, j’ai pensé que je devais en faire quelque chose. Cette période continuait à me travailler, à m’habiter. C’était une évidence que je la raconte. Une question me revenait, tel un motif obsessionnel : à quel moment un peuple se soulève-t-il? Pourquoi en Tunisie cela a-t-il surgi à cet instant précis?
J’ai aussi regardé le documentaire Plus jamais peur, de Mourad Ben Cheikh, et la très belle fiction À peine j’ouvre les yeux, de Leyla Bouzid. Cette jeunesse s’exprimant sur cette révolution me fascinait. Comme Emel Mathlouthi. J’ai été très émue qu’elle chante lors de la remise du prix Nobel de la paix au dialogue national tunisien, en 2015.
Vous vous êtes appuyée sur ces coupures de presse pour construire votre récit des dix jours précédant la chute de Ben Ali, le 15 janvier 2011 ?
Je les ai relues afin de retracer la chronologie jour par jour, de relever les faits marquants. J’ai sans cesse travaillé la narration pour faire coïncider chaque voix avec l’événement historique, me placer au plus près des faits. Ce fut un travail long et minutieux pour ajuster, vérifier les informations. Je me suis aussi appuyée sur le livre de témoignages Dégagé! La révolution tunisienne (Du Layeur, 2011). Je voulais ancrer mon roman dans une profondeur historique. Pour évoquer les années de dictature, j’ai relu des essais à ce sujet. À travers le personnage de Yacine, je parle aussi de l’ère Bourguiba, qui mena le pays vers l’indépendance, période de l’histoire dont le peuple tunisien est très fier.
Écrire Noces de jasmin vous a-t-il éclairé, donné une autre compréhension de la révolution?
C’est difficile de répondre. Je pense qu’à un moment donné les limites sont dépassées. Un acte fort survient, ici l’immolation du jeune vendeur ambulant Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid, et se répercute sur le reste de la population, par un effet domino. Les gens prennent conscience qu’ils peuvent se révolter, pour des raisons vitales - se nourrir, mais aussi avoir accès, pour les étudiants, à des postes qualifiés, réclamer plus de droits, à tous les niveaux. On a aussi découvert l’ampleur de la misère de ces régions désolées, oubliées, d’où est partie la révolution. Les étudiants et jeunes diplômés sans emploi se sont soulevés contre la corruption, le népotisme des familles Ben Ali et Trabelsi. Mais le point de départ du mouvement est avant tout un cri de désespoir et de faim. Mohamed Bouazizi n’était pas un étudiant, contrairement à ce que l’on a longtemps cru [il a longtemps été confondu avec un homonyme, un étudiant s’exprimant sur les réseaux sociaux, ndlr].
Cela vient étayer une question : un peuple qui a accès à l’éducation se révolte-t-il plus qu’un autre?
À travers le personnage de Mehdi, le journaliste, on découvre plus précisément le rôle essentiel du numérique dans le contournement de la censure, la libération de la parole.
Comment l'avez-vous construit?
La thèse menée par mon frère sur la révolution numérique tunisienne m’a aidée. J’ai découvert l’existence de tous ces blogueurs activistes, et comment le collectif Anonymous a fait chuter la structure du site gouvernemental... Cependant, le numérique n’est pas le seul acteur à avoir provoqué la chute du pouvoir. L’armée a joué un rôle important car elle s’est rangée aux côtés du peuple. Ainsi que les manifestations des citoyens, en chair et en os, jusqu’alors interdites. Sous le régime de Ben Ali, les Tunisiens n’avaient pas le droit de se regrouper, de manifester. C’était donc un acte fort. Pendant la révolution, on ressentait beaucoup d’anxiété dans mon entourage. On ne comprenait pas ce qui se passait, les gens avaient peur d’un retournement de situation, d’être emprisonnés après s’être exprimés. On faisait très attention à la façon dont on téléphonait, envoyait nos mails. On n’était pas encore à l’aise. Il y avait une telle incertitude, une peur générale installée depuis tant d’années ! Emprisonné, ce journaliste subit la torture.
Pourquoi faites-vous littéralement parler les murs, en donnant une voix à la Cellule?
C’est un moyen d’aborder la torture pendant la dictature à travers un point de vue omniscient. Pour nourrir cette voix, j’ai relu les essais Notre ami Ben Ali, de Nicolas Beau et Jean-Pierre Turquoi, Tunisie, le livre noir, par Reporters sans frontières, et La Régente de Carthage, de Nicolas Beau et Catherine Graciet. Ainsi que les témoignages de torture que j’avais découverts en France lors de mes études, qui m’avaient empêchée de dormir. Ces ouvrages étaient alors censurés en Tunisie, mais on savait que la torture existait. On changeait de trottoir devant le ministère de l’intérieur. On avait peur. En lisant le roman, mes amis français ont découvert la réalité derrière la carte postale touristique. Car, pendant des années, on n’en parlait pas avec les touristes. On ne s’exprimait pas déjà entre nous! Les Tunisiens
évitaient de parler politique. J’ai mis beaucoup de temps à développer une conscience politique. Je me souviens d’un professeur
du lycée français renvoyé en France dans un vol bleu parce qu’il
avait émis une opinion en classe. Je suis donc très émue encore
aujourd’hui de constater ce bouleversement si rapide, émergé en
seulement trois semaines. Le temps est si étrange dans sa façon
de s’étirer ou de se condenser!
Cette révolution a aussi un impact sur l’intime, exhumant
des secrets de famille: «L’étincelle se met à éclairer les ténèbres de l’Histoire et ravive les petites histoires
singulières, individuelles», confie le personnage d’Essia...
J’essaie sans cesse de lier l’intime au politique, la libération
de la parole avec ces tabous, ces secrets de famille. Je me suis
beaucoup questionnée: est-ce que cette parole intime se libère
petit à petit, ou peut-on tout dire, d’un seul coup, du jour au lendemain ? Je pense qu’elle se déploie plutôt en douceur, au fil
du temps, mais qu’un jour la vérité éclate.
Le personnage de la grand-mère, Mama Maïssa, narre un conte, une allégorie de cette période historique, de la dictature à la révolution...
Elle est garante d’une mémoire, de cette tradition littéraire et orale du conte. Je voulais redonner la parole à ces femmes qu’on n’entend pas assez. Certaines n’ont pas reçu l’instruction par l’école, ne savent ni lire ni écrire mais elles pensent, racontent, s’expriment, véhiculent des idées. Par ce détour par la fiction, l’imaginaire, on dit ce qu’on ne peut pas raconter. J’avais envie d’inventer un conte – c’est l’un de mes défis d’écriture –, de donner une coloration orientale, une dimension « Mille et une nuits » au roman.
Le royaume du conte fait aussi référence à la dictature, suggère une résolution de l’énigme, du mystère de cette révolution. Je l’ai conçu comme une composition musicale dans ce roman
choral, d’où son nom, Fugue. Dans une fugue musicale, les voix
s’entremêlent et se chassent les unes les autres. Ici, une voix
forte, symbolique chasse le tyran.
L’amour, la sensualité, l’éros sont aussi très présents dans
le livre. C’était important, pour vous?
Oui. Cette voix relève de l’intime, donc il n’y a pas de raison de la censurer. C’est peut-être audacieux de l’intégrer à un
roman tunisien, car c’est encore un tabou, mais c’est important
de se l’autoriser. L’écriture de Marguerite Duras dans L’Amant
me fascine. J’aime sa sensualité.
Autre thème souvent évoqué: le métissage, la double
culture. «Mon métissage est d’une infinité de nuances, comme Tunis [...] Des pans de civilisation se sont croisés,
entrecroisés, mêlés », témoigne Essia.
Je suis moi-même métisse. Depuis mon enfance, je m’interroge sur la double culture, cet entre-deux. Mon père est tunisien, ma mère est française, blonde aux yeux bleus. C’est une
«Ch’ti» du Nord de la France, où je passais enfant tous mes
étés, dans un village près de Cambrai. On attendait ce moment
toute l’année! Nous prenions le bateau depuis Tunis jusqu’à
Marseille, une traversée de 24 heures, puis nous remontions
la France en voiture. Un voyage qui m’a donné l’envie de partir
sur les routes, plus tard. Mon frère et ma sœur sont blonds aux
yeux bleus, on ne se ressemble pas, et les gens nous perçoivent
d’une manière différente. Pour beaucoup, le métissage est physique, alors que c’est beaucoup plus complexe. Il est vécu différemment rien qu’au sein d’une même famille. Je n’ai pas le même rapport à la France, à la Tunisie, à
la langue que mon frère et ma sœur. J’ai
été scolarisée au lycée français Pierre-
Mendès-France de Tunis, où l’on rencontre des jeunes de toutes les cultures.
Ce mélange, cette richesse sont des
repères très forts pour moi. Car, en
Tunisie ou en France, je ne me sentais
jamais complètement tunisienne, jamais
complètement française, parfois à moitié française, à moitié tunisienne... C’est
une question complexe et intéressante
à aborder. Nous, les Franco-Tunisiens,
nous votions déjà en France, mais nous
étions très fiers de le faire pour la première fois en Tunisie après la révolution!
Une mise à niveau des deux pans de
notre identité, au niveau politique, de la
liberté de parole.
Vous citez l’écrivain et essayiste
tunisien Albert Memmi. Que représente-t-il pour vous?
Il m’a bouleversée quand j’avais
20 ans, pendant mes études de lettres à
la Sorbonne. La lecture de son roman La Statue de sel, où il
raconte son tiraillement entre les différents pans de son identité, a été un vrai choc. Je l’ai rencontré pour mon mémoire de
maîtrise, que j’ai consacré à ses œuvres. On a correspondu pendant longtemps [Albert Memmi, né en 1920, est décédé le 22 mai
2020, ndlr]. Il est une figure littéraire très importante pour
moi. Ses fictions comme ses écrits sociologiques, tels L’homme
dominé ou Le Portrait du colonisé, m’ont structurée, dans ma
vie comme dans ma façon d’aborder la littérature. C’était très
enrichissant d’échanger avec un homme de cette génération.
Il me parlait de cette Tunisie coloniale, peut-être encore plus
métissée que celle d’aujourd’hui car demeuraient encore les Italiens, les Siciliens, les juifs – lesquels sont presque tous partis... Le couple de mes parents, puis ma naissance, celle de mon frère
et de ma sœur, sont le résultat de ces rencontres culturelles.
Partagée entre deux pays, votre double culture vous a-t-elle donné le goût du voyage, de la découverte de l’autre?
Oui. C’est une recherche de soi à travers les voyages, mais
aussi un enrichissement à travers la rencontre de l’autre, qui
transforme votre vie. Plus que le métissage, c’est la rencontre
interculturelle qui m’attire: qu’est-ce qu’on en fait, quel impact
sur l’identité d’une personne, son évolution... J’ai la bougeotte,
et je m’interroge sur «le même et l’autre», être pareil et diffé-
rent. Très jeune, j’ai eu envie d’aller découvrir l’ailleurs. J’aime
partir en voyage avec mon sac à dos, mais c’est aussi important
de s’ancrer dans un pays quelque temps, pour en saisir en pro-
fondeur la culture, les mœurs, la façon de vivre. Mon premier
pays d’expatriation fut la France, où je suis arrivée à 18 ans pour
mes études. Un ailleurs qui était déjà en moi. J’ai vécu treize
ans à Paris, une ville-monde riche en possibilités pour s’éva-
der très vite, avec les quartiers indiens, africains... toute l’offre
culturelle. Pendant mes études, j’ai fait un stage en Inde pour
enseigner le français à l’Alliance française, pendant six mois, à
Bombay et à Chennai. Puis j’ai enseigné trois mois en Équateur,
et étudié un an à Londres avec le programme Erasmus.
D’où vient votre passion pour l’Inde?
C’est un pays fascinant qui m’a énormément nourrie. C’est
là que j’ai eu le sentiment d’être à la fois la même et l’autre.
J’ai trouvé une ressemblance, des similitudes culturelles avec
la Tunisie. Cet héritage de la religion musulmane, les vêtements
très colorés, chargés, ornés de paillettes, la présence du jasmin... Ma recherche de DEA [diplôme d’études approfondies,
ndlr] comparait l’héritage culturel et cultuel dans la littérature
de la diaspora indienne des Antilles anglophones et franco-phones (Trinidad, Guadeloupe, Martinique).
Les pays d’Afrique de l’Ouest sont votre deuxième culture
de cœur...
En effet. À Paris, je faisais de la danse guinéenne, je jouais
des percussions. J’ai effectué plusieurs voyages de danse et de
musique en immersion en Guinée. Et j’ai eu un coup de cœur
pour le Sénégal, lors d’un séjour touristique. Dakar est la jumelle
de Tunis: une ville balnéaire avec une corniche, une atmos-
phère proche mais en version Afrique de l’Ouest... Je me suis
sentie très vite chez moi. J’y ai retrouvé des pans de ma culture
tunisienne, car il y a des Mauritaniens, des Tunisiens expatriés,
des Libanais... Et des Sénégalais se rendent aussi en Tunisie
pour étudier ou travailler. J’ai donc candidaté pour un poste de
professeur de lettres au lycée français Jean-Mermoz de Dakar
et j’y suis restée trois ans.
Vous êtes actuellement en poste à Madagascar, à Antananarivo. Comment vivez-vous cette expérience?
Pour la première fois, je me sens autre, j’ai du mal à trouver
le « même ». J’y ai beaucoup moins de repères, et ça m’interroge,
me passionne, sur un plan identitaire. Pour quelles raisons ? Parfois, on retrouve des détails, des odeurs, des habits, des énergies,
des façons d’être. Depuis peu, je découvre des croyances ancestrales similaires à celles de mon pays natal. C’est en passant du
temps dans un endroit que l’on apprend ces choses, parfois ça va
très vite, pour d’autres pays il faut creuser, chercher. En plus de
l’enseignement, je suis formatrice d’enseignants dans les lycées
français de la zone océan Indien. Donc je passe ma vie à bouger,
entre Maurice, les Comores, les Seychelles. J’aime beaucoup La
Réunion également, une île-monde, une mosaïque identitaire
composée d’héritages africain, indien, du monde arabe... Elle
concentre tout ce que j’aime: la montagne et la mer, les danses
africaines et indiennes, le mélange des cultures, une facilité de
parole...
Comment transmettez-vous le goût de lire à vos élèves?
Ma vision s’oppose à la notion de programme de littérature,
classée par genre ou par âge. Car on peut relire des œuvres à
différentes périodes du cursus. Plutôt que cette codification qui
peut repousser certains élèves, je préfère y entrer par le concret,
avec des thèmes comme « regarder le monde », « recherche de
soi », « l’humanité et sa violence », etc. Ce réel nous amène à redécouvrir les classiques, et c’est alors intéressant de les mettre en
regard avec des œuvres contemporaines. Je me passionne pour
le sujet lecteur: comment permettre à un élève de parler d’un
livre d’une manière créative, autrement que par une fiche de
lecture standard ? Et je les fais beaucoup écrire. Les contraintes
techniques peuvent être données comme indicatives, mais ne
doivent pas constituer une entrave. Pour citer Marguerite Duras
dans son essai Écrire, l’écriture est un mouvement.